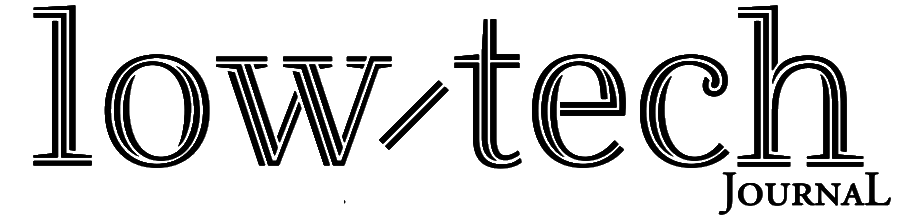"J’avais besoin de me sentir utile ; de faire partie de la solution, plutôt que du problème", entretien avec Quentin Mateus du Low-Tech Lab
Publié par Jacques Tiberi dans Extrait du mag le 03/03/2023 à 15:18

Quentin Mateus, figure du Low-Tech Lab, publie Perspectives Low-Tech, co-écrit avec Gauthier Roussilhe. Un bouquin prometteur, une brique de plus dans la refondation écologique et sociale de notre société.
Lire l'intégralité de l'entretien dans le n°6 du Low-Tech Journal, à découvrir ici
Enfant, Quentin se rêvait designer automobile. Il se lance dans des études d’ingénierie à l’Université de Technologie de Compiègne. Mais ses stages dans l’industrie automobile le mettent face à une dissonance cognitive. Il s'intéresse alors aux sciences humaines et aux voyages. Il aurait aimé être anthropologue. Sa petite crise existentielle le conduit à rejoindre, en 2016, le Jute Lab lors d'un service civique au Bangladesh puis à Concarneau, où il démarre le projet Agami pour une mobilité plus low-tech. En 2020, avec le Low-Tech Lab, il se lance dans une tournée des acteurs de la low-tech à travers des enquêtes de terrain.
Depuis peu, il co-anime, avec Julie Mittelmann, l'expérimentation de démarche low-tech à l'échelle de l'agglomération de Concarneau-Cornouaille, qui s'inspire des découvertes, apprentissages et modèles rencontrés, notamment, dans le cadre de ses enquêtes. Il contribue aussi aux missions plus transverses du Low-tech Lab en vue d'en faire un commun au service de l'émergence d'une culture et d'une société plus low-tech.
JT : Peu de livres sont consacrés à la low-tech. L'Âge des Low-Tech, de Philippe Bihouix, pose le constat global. Et Repenser nos technologies pour un monde durable de Clément Chabot et Pierre-Alain Lévêque offre un témoignage de transition à l'échelle d'un foyer. J'ai l'impression que votre livre se positionne à mi-chemin, pour proposer des réponses à l'échelle locale.
QM : Je ne suis pas certain qu'on se soit restreints à cette échelle locale ; même si, plus j'avance, et plus ça me paraît évident que la démarche low-tech ne peut avoir de sens qu'à une échelle humaine. Simplement parce qu'elle part des besoins et des moyens d'y répondre de façon soutenable, plus autonome. Mais, je suis de plus en plus convaincu qu'il faut penser la suite du monde actuel à d'autres échelles : régionales, nationales et macroéconomiques. Comment hériter d'un certain nombre d'infrastructures à ces échelles, comment s'en servir pour échanger, migrer et communaliser des usages, des ressources, des savoir-faire et des expériences ? Comment organiser la société de façon pérenne et conviviale (au sens d'Illich), tout en articulant cela à différentes échelles ? Je pense aux exemples de confédéralisme, de sécurité sociale sectorielle, voire de cosmo-localisme (design global, manufacture locale). En réalité, il s'agit de penser des organisations cohérentes à ces échelles, distinctes de celles qui nous paraissent tellement normales qu'on ne les voit plus : autre chose que le marché comme seule économie, autre chose que les bullshit jobs comme seul horizon professionnel, autre chose que la propriété privée comme seule sécurité...
JT : En effet, dans le livre, vous appelez à sortir des logiques marchandes, à privilégier la gratuité. Quel est ton regard sur la décroissance ?
QM : La décroissance est pour moi un ensemble de pensées et de penseurs très pluriel - et donc nourrissant. Certains précurseurs sont des vraies sources d'inspiration en matière de critique ou de changement de rapport au travail et à la valeur. Je pense à William Morris qui promeut l'artisanat et parle d'un travail digne à partir du moment où il est utile, où on en tire un gain direct, et où il permet du repos. Je pense à Illich, à Alain Caillé et son anthropologie du don. Mais aussi aux chercheurs-praticiens de Cargonomia, rencontrés lors des Enquêtes du Low-Tech Lab et qui incarnent les valeurs de la décroissance tant dans leur modèle d'activité, que la forme de leur organisation. Finalement c'est comme une sorte de grande école d'éducation à l'esprit critique face à notre modèle.
JT : Quels sont les lieux où tu as vu se dessiner le futur et que tu recommandes à nos lecteurs de visiter ?
QM : Hmmm... j'ai été bluffé par la Gob à Bressuire, l'Agronaute à Nantes, le Hangar zéro au Havre, le Couvent des clarisses à Roubaix, les locaux de l'Atelier paysan à Renage, ceux d'Aezeo à Lorient, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, la communauté Precious Plastic à Eindhoven... Il y a aussi des endroits qui m'attirent, mais où je n'ai pas pu me rendre, faute de temps et de crédit carbone suffisant, comme le Chiapas zapatiste au Mexique, ou le Rojava kurde au nord-est de la Syrie.
JT : Dans le livre, vous dites que des logiques autoritaires sont aujourd'hui à l’oeuvre dans la Tech et dans la société en général, qu'est-ce que vous entendez par là ?
QM : Qui peut se targuer d'avoir fait démocratiquement un choix social et technique, récemment ? La plupart de ces choix sont technocratiques. Ils sont imposés à la population pour son bien ou celui de l'économie et/ou par la pub... quand ce n'est pas pour le bien de la planète, sous forme de greenwashing mal senti... C'est Lewis Mumford qui distinguait ces deux types de techniques : autoritaire ou démocratique. Il plaidait pour refaire de la production, de l'outil et de la technique, un objet politique au coeur de la citoyenneté et de la cité. Il appelait au retour vers la "technique démocratique" : une production à petite échelle, peu consommatrice de ressources, facile à adapter et à reproduire, et surtout placée sous la direction de l'artisan ou de l’agriculteur, dont le geste s'apparente à un art.
JT : Tous ces voyages et ces enquêtes t'ont-ils appris comment rendre la low-tech désirable au plus grand nombre ?
QM : Pour moi la low-tech doit plutôt imposer d'autres standards que ceux de l'imaginaire dominant. C'est un monde avec plus de relations, de proximité, d'activités manuelles ou artisanales, d'entretien, de soin des choses, des gens et des écosystèmes. Bref, un monde plus libre et plus autonome. Il y a une bataille culturelle à mener pour donner à désirer d'autres paradigmes, d'autres modes de vie, d'autres modèles de réussite ou de société. Et ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas très difficile : il suffit de valoriser et de raconter, sans les idéaliser, tous les avantages humains, profonds qu'il y a à une société plus low-tech.
(Photo de couverture par le Low-Tech Lab).
Pour découvrir le Low-Tech Journal, c'est par ici !
Boutique propulsée par Wizishop